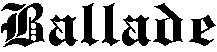
Elle rassemble tout d'abord trois groupes de vers (strophes ou couplets) comportant autant de vers que ceux-ci comportent de syllabes(strophes carrées, majoritaires depuis Jean Molinet).
La petite Ballade s'écrivant en
vers de huit syllabes
(octosyllabes), les trois strophes comptent
donc huit vers
(huitains),
tandis que la grande Ballade placent ces
vers de dix syllabes
(décasyllabes) dans des groupes
de dix vers
(dizains).
Ces trois strophes coulées dans le même moule
finissent par le même vers
(refrain) et reproduisent
une disposition de rimes identique : le poème
entier doit reposer sur seulement trois rimes !
Néanmoins, l'incompatibilité entre un système rigide sur trois rimes et leurs dispositions dans des strophes de longueurs(ou plutôt de hauteurs) différentes conduit à un schéma de rimes forcément lui aussi différent entre la petite et la grande Ballade, bien que le principe soit le même : renversement de la dispostion des rimes pour la seconde moité de la strophe.
| Pour les huitains de la petite Ballade, le pivot est assuré par deux rimes suivies (ici b, C = Refrain) |
a b a b --- b c b C |
|
| soit pour les trois strophes : | abab-bcbC abab-bcbC abab-bcbC. |
|
| Pour les dizains de la grande
Ballade, on est obligé de multiplier le nombre de rimes suivies pour opérer le renversement |
a b a b b --- b b c b C |
Cliquez
sur |
| soit pour les trois strophes : | ababb-bbcbC ababb-bbcbC ababb-bbcbC. |
|
| Mais la succession de quatre rimes identiques étant monotone, on a préféré à raison introduire une quatrième rime (d) |
a b a b b --- d d c d C |
|
| soit pour les trois strophes : | ababb-ddcdC ababb-ddcdC ababb-ddcdC. |
|
| Les deux moitiés sont bien formellement renversées c-à-d symétriques horizontalement ("en miroirs"), mais elles n'ont plus les mêmes rimes. |
a, b / d, c |
|
La Ballade se conclue par un envoi qui répète en écho la forme de la seconde moitié des strophes :
|
|
Son rôle ira en s'amplifiant autant dans son contenu que dans
sa forme,
au point d'en faire parfois le point culminant du poème :
| En ajoutant
l'Envoi aux
trois couplets, on obtient alors les structures complètes suivantes : |
|
||||||||||||||||||||
| Exemple : | Ballade des menus propos | de François Villon | ||||||||||||||||||
= Huitains d'Octosyllabes |
I. | |||||||||||||||||||
| 1 - | Je connais bien mouches en LAIT, | Première moitié | a | |||||||||||||||||
| 2 - | Je connais à la robe l'hOMME, | abab- | b | |||||||||||||||||
| 3 - | Je connais le beau temps du LAID, | a | ||||||||||||||||||
| 4 - | Je connais au pommier la pOMME, | Rimes | b | |||||||||||||||||
| 5 - | Je connais l'arbre à voir la gOMME, | "pivot" | Seconde moitié | b | ||||||||||||||||
| 6 - | Je connais quand tout est de MÊMES, | -bcbC | c | |||||||||||||||||
| 7 - | Je connais qui besogne ou chÔME, | b | ||||||||||||||||||
| 8 - | JE CONNAIS TOUT, FORS QUE MOI-MÊMES. | (REFRAIN) | C | |||||||||||||||||
| II. | ||||||||||||||||||||
| 1 - | Je connais pourpoint au colLET, | Première moitié | a | |||||||||||||||||
| 2 - | Je connais le moine à la gONNE, | abab- | b | |||||||||||||||||
| 3 - | Je connais le maître au vaLET, | a | ||||||||||||||||||
| 4 - | Je connais au voile la nONNE, | Rimes | b | |||||||||||||||||
| 5 - | Je connais quant pipeur jargONNE, | "pivot" | Seconde moitié | b | ||||||||||||||||
| 6 - | Je connais fols nourris de crEMES, | -bcbC | c | |||||||||||||||||
| 7 - | Je connais le vin à la tONNE, | b | ||||||||||||||||||
| 8 - | JE CONNAIS TOUT, FORS QUE MOI-MÊMES. | (REFRAIN) | C | |||||||||||||||||
| III. | ||||||||||||||||||||
| 1 - | Je connais cheval et muLET, | Première moitié | a | |||||||||||||||||
| 2 - | Je connais leur charge et leur sOMME. | abab- | b | |||||||||||||||||
| 3 - | Je connais Bietris et BeLET, | a | ||||||||||||||||||
| 4 - | Je connais jet qui nombre et sOMME. | Rimes | b | |||||||||||||||||
| 5 - | Je connais vision et sOMME, | "pivot" | Seconde moitié | b | ||||||||||||||||
| 6 - | Je connais la faute des BohEMES, | -bcbC | c | |||||||||||||||||
| 7 - | Je connais le pouvoir de ROME, | b | ||||||||||||||||||
| 8 - | JE CONNAIS TOUT, FORS QUE MOI-MÊMES. | (REFRAIN) | C | |||||||||||||||||
| Envoi | ||||||||||||||||||||
| 1 - | Prince, je connais tout en sOMME. | (Dédicataire) | (Seconde moitié) | b | ||||||||||||||||
| 2 - | Je connais colorés et blÊMES, | bcbC | c | |||||||||||||||||
| 3 - | Je connais Mort qui tout consOMME, | b | ||||||||||||||||||
| 4 - | JE CONNAIS TOUT, FORS QUE MOI-MÊMES. | (REFRAIN) | C | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Exemple : | Ballade des pendus | de François Villon | ||||||||||||||||||||||
= Dizains de Décasyllabes |
||||||||||||||||||||||||
| I. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 - | Frères humains qui après nous vivez, | Première moitié | a | |||||||||||||||||||||
| 2 - | N'ayez les cœurs contre nous endurcis, | ababb- | b | |||||||||||||||||||||
| 3 - | Car, si pitié de nous pauvres avez, | a | ||||||||||||||||||||||
| 4 - | Dieu en aura plus tôt de vous mercis, | b | ||||||||||||||||||||||
| 5 - | Vous nous voyez (i)ci attachés cinq, six : | Rimes | b | |||||||||||||||||||||
| 6 - | Quant à la chair, que trop avons nourrie, | "pivot" | Seconde moitié | d | ||||||||||||||||||||
| 7 - | Elle est pieça dévorée et pourrie, | -ddcdC | d | |||||||||||||||||||||
| 8 - | Et nous les os, devenons cendre et poudre. | c | ||||||||||||||||||||||
| 9 - | De notre mal personne ne s'en rie ; | d | ||||||||||||||||||||||
| 10 - | MAIS PRIEZ DIEU QUE TOUS NOUS VEUILLE ABSOUDRE ! | (REFRAIN) | C | |||||||||||||||||||||
| II. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 - | Si frères vous clamons, pas n'en devez | Première moitié | a | |||||||||||||||||||||
| 2 - | Avoir dédain, quoique fûmes occis | ababb- | b | |||||||||||||||||||||
| 3 - | Par justice. Toutefois, vous savez | a | ||||||||||||||||||||||
| 4 - | Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis ; | b | ||||||||||||||||||||||
| 5 - | Excusez-nous, puisque nous sommes transsis, | Rimes | b | |||||||||||||||||||||
| 6 - | Envers le fils de la Vierge Marie, | "pivot" | Seconde moitié | d | ||||||||||||||||||||
| 7 - | Que sa grâce ne soit pour nous tarie, | -ddcdC | d | |||||||||||||||||||||
| 8 - | Nous préservant de l'infernale foudre. | c | ||||||||||||||||||||||
| 9 - | Nous sommes morts, âme ne nous harie ; | d | ||||||||||||||||||||||
| 10 - | MAIS PRIEZ DIEU QUE TOUS NOUS VEUILLE ABSOUDRE ! | (REFRAIN) | C | |||||||||||||||||||||
| III. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 - | La pluie nous a débus et lavés, | Première moitié | a | |||||||||||||||||||||
| 2 - | Et le soleil desséchés et noircis ; | ababb- | b | |||||||||||||||||||||
| 3 - | Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés, | a | ||||||||||||||||||||||
| 4 - | Et arraché la barbe et les sourcils. | b | ||||||||||||||||||||||
| 5 - | Jamais nul temps nous ne sommes assis ; | Rimes | b | |||||||||||||||||||||
| 6 - | Puis *çà, puis là, comme le vent varie, | "pivot" | Seconde moitié | d | ||||||||||||||||||||
| 7 - | À son plaisir sans cesser nous charrie, | -ddcdC | d | |||||||||||||||||||||
| 8 - | Plus béquetés d'oiseaux que dés à coudre. | c | ||||||||||||||||||||||
| 9 - | Ne soyez donc de notre confrérie ; | d | ||||||||||||||||||||||
| 10 - | MAIS PRIEZ DIEU QUE TOUS NOUS VEUILLE ABSOUDRE ! | (REFRAIN) | C | |||||||||||||||||||||
| Envoi | ||||||||||||||||||||||||
| 1 - | Prince Jésus, qui sur tous à maistrie, | (Dédicataire) | (Seconde moitié) | d | ||||||||||||||||||||
| 2 - | Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie : | -ddcdC | d | |||||||||||||||||||||
| 3 - | À lui n'ayons que faire ni que soudre. | c | ||||||||||||||||||||||
| 4 - | Hommes, ici n'a point de moquerie ; | d | ||||||||||||||||||||||
| 5 - | MAIS PRIEZ DIEU QUE TOUS NOUS VEUILLE ABSOUDRE ! | (REFRAIN) | C | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
(D'après la danse la Ronde, qu'il accompagnait de son
chant)
Autour du mot Rondeau gravitent
les formes de poèmes courts les plus répandues du
Moyen-Âge,
et ce jusqu'au XVIe siècle.
Cette efficacité tient
à sa très forte structuration qui permet d'unir et de
condenser à l'extrême, autour de puissantes lignes de forces,
quelques vers pour en faire un poème mémorable :
modèle de brièveté et de productivité se
prêtant particulièrement bien à l'Improvisation et
la Création spontanée ! L'Éphémère
prend ici les traits imparables de l'Éternité. Un élan
figé dans le marbre.
Quant à la Satire, elle n'en devient que plus
implacable.
Cette prouesse est, comme souvent, réalisée à l'aide
du procédé de "l'Éternel Retour":
les puissantes lignes de forces autour duquel s'articulent le poème,
ce sont les simples répétitions, à des endroits
stratégiques, d'une partie du premiers vers
(Rondeau proprement dit), ou du premier
et/ou du second tout entier (Rondel
et Triolet). (Peut-être
la désignation d'un poème sans titre par son début
(Incipit) vient-elle de là...)
| Rondeau simple : |
Se restreignant à seulement deux rimes (A et B), il se compose de trois groupes (strophes) de vers de huit syllabes (octosyllabes) ou de dix (décasyllabes) :
Sur cet exemple de François
Villon,
notez l'utilisation caractéristique chez lui de la ponctuation
pour changer le sens du rentrement.
| Exemple : | Chanson (Rondeau simple) | de Villon | ||||||||||||||||
|
= Octosyllabes | |||||||||||||||||
| I. | (Rentrement) | |||||||||||||||||
| 1 - | Au retour de dure prison | a | ||||||||||||||||
| 2 - | Où j'ai presque laissé la vie, | b | ||||||||||||||||
| 3 - | Si Fortune a sur moi envie | b | ||||||||||||||||
| 4 - | Jugez s'elle fait méprison ! | a | ||||||||||||||||
| II. | ||||||||||||||||||
| 1 - | Il me semble que, par raison, | a | ||||||||||||||||
| 2 - | Elle dût bien être assouvie | b | ||||||||||||||||
| Au retour. | Rentrement | |||||||||||||||||
| III. | ||||||||||||||||||
| 1 - | Si si pleine est de déraison | a | ||||||||||||||||
| 2 - | Que veuille que du tout dévie, | b | ||||||||||||||||
| 3 - | Plaise à Dieu que l'Âme ravie | b | ||||||||||||||||
| 4 - | En soit lassus, en sa maison, | a | ||||||||||||||||
| Au retour ! | Rentrement |
Pour d'autres exemples,
allez voir notre mini-anthologie de François
Villon :
(vous pouvez cliquez ci-dessus sur son nom).
| Rondeau double : |
Toujours sur deux rimes (A et B) avec des vers de huit syllabes (octosyllabes) ou de dix (décasyllabes), il ajoute cependant à chaque groupe (strophe) un vers dont la rime double la première de chaque strophe :
Cette variante l'a emporté finalement sur toutes les autres
grâce notamment au talent de Clément
Marot.
L'exemple qui suit est d'autant plus intéressant
qu'il donne la définition du Rondeau simple
dans la forme même de sa définition !
| Exemple : | Rondeau double | de Voiture | ||||||||||||||||||||
|
= Décasyllabes | |||||||||||||||||||||
| I. | (Rentrement) | |||||||||||||||||||||
| 1 - | Ma foi, c'est fait de moi, car Isabeau | a | ||||||||||||||||||||
| 2 - | M'a conjuré de lui faire un Rondeau. | a | ||||||||||||||||||||
| 3 - | Cela me met dans une peine extrême. | b | ||||||||||||||||||||
| 4 - | Quoi ! treize vers, huit en eau, cinq en ême ! | b | ||||||||||||||||||||
| 5 - | Je lui ferais aussi tôt un bateau. | a | ||||||||||||||||||||
| II. | ||||||||||||||||||||||
| 1 - | En voilà cinq pourtant en un morceau. | a | ||||||||||||||||||||
| 2 - | Faisons-en sept en invoquant Brodeau, | a | ||||||||||||||||||||
| 3 - | Et puis mettons, par quelque stratagème : | |||||||||||||||||||||
| Ma foi, c'est fait. | Rentrement | |||||||||||||||||||||
| III. | ||||||||||||||||||||||
| 1 - | Si je pouvais encor de mon cerveau | a | ||||||||||||||||||||
| 2 - | Tirez cinq vers, l'ouvrage serait beau. | a | ||||||||||||||||||||
| 3 - | Mais cependant me voilà dans l'onzième, | b | ||||||||||||||||||||
| 4 - | Et si je crois que je fais le douzième, | b | ||||||||||||||||||||
| 5 - | En voilà treize ajustés de niveau. | a | ||||||||||||||||||||
| Ma foi, c'est fait. | Rentrement |
| Triolet ou Rondel simple : |
C'est à partir de cette forme extrêmement ramassée
qu'on a ensuite évolué par amplification vers le Rondeau.
Toujours divisé en trois et en vers octo- ou déca-syllabes
sur deux rimes, la différence la plus importante est
la répétition qui s'applique non
plus à une partie du début du premier vers mais
à une combinaison variable des deux premiers
vers tout entier.
La légèreté et la très grande "lisibilité"
du Triolet permet sans problèmes de telles
réitérations :
| Exemple : | Rondeau (Triolet) | de Villon | ||||||||||
|
= Pentasyllabes | |||||||||||
| I. | = Refrain variable | |||||||||||
| 1 - | JENIN L'AVENU | A Refrain | ||||||||||
| 2 - | VA T'EN AUX ÉTUVES, | B Refrain | ||||||||||
| II. | ||||||||||||
| 1 - | Et toi la venu, | a | ||||||||||
| 2 - | JENIN L'AVENU, | A Refrain | ||||||||||
| III. | ||||||||||||
| 1 - | Si te lave nu | a | ||||||||||
| 2 - | Et te baigne es cuves. | b | ||||||||||
| 3 - | JENIN L'AVENU, | A Refrain | ||||||||||
| 4 - | VA T'EN AUX ÉTUVES. | B Refrain |
Comme toujours, la légèreté de la forme a conduit souvent
à la légèreté du sujet traité...
jusqu'à Mallarmé lui-même
!
Notons en tout : cinq vers différents / un poème de huit
vers... un véritable modèle d'économie !
| Rondel : |
Presque identique au Rondeau simple, on peut dire qu'il
combine "incestueusement" le Rondeau avec le Triolet :
seul le rentrement est remplacé par la
répétition variable (inversée) des deux premiers
vers.
| Exemple : | Rondeau (Rondel) |
de Charles d'Orléans | ||||||||||||||||
|
= Octosyllabes | |||||||||||||||||
| I. | ||||||||||||||||||
| 1 - | LE TEMPS A LAISSÉ SON MANTEAU | A Refrain | ||||||||||||||||
| 2 - | DE VENT, DE FROIDURE ET DE PLUIE, | B Refrain | ||||||||||||||||
| 3 - | Et s'est vêtu de broderie, | b | ||||||||||||||||
| 4 - | De soleil luisant, clair et beau. | a | ||||||||||||||||
| II. | ||||||||||||||||||
| 1 - | Il n'y a bête, ni oiseau, | a | ||||||||||||||||
| 2 - | Qu'en son jargon ne chante ou crie : | b | ||||||||||||||||
| 3 - | LE TEMPS A LAISSÉ SON MANTEAU | A Refrain | ||||||||||||||||
| 4 - | DE VENT, DE FROIDURE ET DE PLUIE, | B Refrain | ||||||||||||||||
| III. | ||||||||||||||||||
| 1 - | Rivière, fontaine et ruisseau | a | ||||||||||||||||
| 2 - | Portent, en livrée jolie, | b | ||||||||||||||||
| 3 - | Gouttes d'argent d'orfèvrerie, | b | ||||||||||||||||
| 4 - | Chacun s'habille de nouveau : | a | ||||||||||||||||
| 5 - | LE TEMPS A LAISSÉ SON MANTEAU | A Refrain | ||||||||||||||||
| 6 - | DE VENT, DE FROIDURE ET DE PLUIE, | B Refrain |
Il est ici important de signaler que la frontière entre Rondel
et Rondeau peut être encore plus floue... voire illusoire
:
en effet, les copistes du Moyen-Âge avaient l'habitude de ne marquer
que le début d'un vers pour noter sa répétition
!
Jugez par vous-mêmes : le poème suivant de
Villon est traditionellement
présenté comme un Rondeau
mais il peut très bien s'apprécier en forme de
Rondel. Les deux versions sont placées
ici côte à côte.
| Rondeau | I. | Rondel |
Mort, j'appelle de ta rigueur, |
Mort, j'appelle de ta rigueur, | |
Qui m'as ma maîtresse ravie, |
Qui m'as ma maîtresse ravie, | |
Et n'es pas encore assouvie |
Et n'es pas encore assouvie | |
Si tu ne me tiens en langueur : |
Si tu ne me tiens en langueur : | |
| II. | ||
Onc puis n'eus force ni vigueur ; |
Onc puis n'eus force ni vigueur ; | |
Mais que te nuisait elle en vie, |
Mais que te nuisait elle en vie, | |
| Mort ? | Mort, j'appelle de ta rigueur ; | |
| Qui m'as ma maîtresse ravie ? | ||
| III. | ||
Deux étions et n'avions qu'un cœur ; |
Deux étions et n'avions qu'un cœur ; | |
S'il est mort, force est que devie, |
S'il est mort, force est que devie, | |
Voire, ou que je vive sans vie |
Voire, ou que je vive sans vie | |
Comme les images, par cœur, |
Comme les images, par cœur, | |
| Mort ! | Mort, j'appelle de ta rigueur ! |
On perd évidemment la puissance de la ponctuation
originale,
mais on peut s'amuser à faire subir ce traitement à
beaucoup de Rondels et
Rondeaux...!
| Rondel double : |
On atteint ici probablement la limite du principe : le quatrain initial est intégralement répété à la fin !
| Rondeau parfait : |
Ceux qui prennent ces Temps reculés pour une époque de barbares en seront pour leurs frais :
voici une forme d'une extrême complexité qui nous permettra d'admirer la virtuosité de Clément Marot.
| Exemple : | Rondeau parfait |
de Clément Marot | ||||||||||||||||||||
|
= Décasyllabes | |||||||||||||||||||||
| I. | (Rentrement) | |||||||||||||||||||||
| 1 - | EN LIBERTÉ MAINTENANT ME PROMÈNE, | I.-1 A Refrain | ||||||||||||||||||||
| 2 - | MAIS EN PRISON POURTANT JE FUS CLOUÉ ; | I.-2 B Refrain | ||||||||||||||||||||
| 3 - | VOILÀ COMMENT FORTUNE ME DEMAINE : | I.-3 A Refrain | ||||||||||||||||||||
| 4 - | C'EST BIEN ET MAL. DIEU SOIT DU TOUT LOUÉ. | I.-4 B Refrain | ||||||||||||||||||||
| II. | ||||||||||||||||||||||
| 1 - | Les envieux ont dit que de Noué | |||||||||||||||||||||
| 2 - | N'en sortirais ; que la mort les emmène ! | |||||||||||||||||||||
| 3 - | Malgré leurs dents le noeud est dénoué : | |||||||||||||||||||||
| 4 - | EN LIBERTÉ MAINTENANT ME PROMÈNE. | I.-1 A Refrain | ||||||||||||||||||||
| III. | ||||||||||||||||||||||
| 1 - | Pourtant, si j'ai fâché la Cour Romaine, | |||||||||||||||||||||
| 2 - | Entre méchants ne fus oncq alloué : | |||||||||||||||||||||
| 3 - | De biens famés j'ai hanté le domaine, | |||||||||||||||||||||
| 4 - | MAIS EN PRISON POURTANT JE FUS CLOUÉ. | I.-2 B Refrain | ||||||||||||||||||||
| IV. | ||||||||||||||||||||||
| 1 - | Car aussitôt que fus désavoué | |||||||||||||||||||||
| 2 - | De celle-là qui me fus tant humaine, | |||||||||||||||||||||
| 3 - | Bien tôt après à Saint Pris fus voué ; | |||||||||||||||||||||
| 4 - | VOILÀ COMMENT FORTUNE ME DEMAINE. | I.-3 A Refrain | ||||||||||||||||||||
| V. | ||||||||||||||||||||||
| 1 - | J'eus à Paris prison fort inhumaine ; | |||||||||||||||||||||
| 2 - | À chartres fus doucement encloué ; | |||||||||||||||||||||
| 3 - | Maintenant vais où mon plaisir me mène : | |||||||||||||||||||||
| 4 - | C'EST BIEN ET MAL. DIEU SOIT DU TOUT LOUÉ. | I.-4 B Refrain | ||||||||||||||||||||
| VI. | ||||||||||||||||||||||
| 1 - | Au fort, amis, c'est à vous bien joué, | |||||||||||||||||||||
| 2 - | Quand votre main hors du parc me ramène | |||||||||||||||||||||
| 3 - | Ecrit et fait d'un coeur bien enjoué, | |||||||||||||||||||||
| 4 - | Le premier jour de la verte semaine, | |||||||||||||||||||||
En liberté. |
Rentrement |
Au vu de tous ces exemples, la caractéristique la plus
stimulante
de ces formes pour un créateur est évidemment
l'utilisation de la partie répétée
dans différents contextes et réseaux de significations
pour en changer (ou en creuser) le sens à chaque fois.